

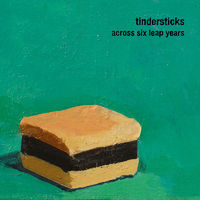
Tindersticks - Across Six Leap Years
Sortie le 7 novembre 2013
Note : 4/5
À la fin des années 90, un camarade mélomane me décrivait la musique des Tindersticks en ces termes : « C’est super pour faire l’amour ». S’en était alors suivie une grosse stupeur dès les premières écoutes : ce groupe jouait bien à l’horizontale, mais dans des draps froids et abandonnés.
Si dimension sexuelle il y avait, elle était surtout due à la voix et à l’attitude du chanteur, Stuart Staples. Faux dandy mais véritable beautiful loser, il excellait dans l’art de maintenir un équilibre précaire entre élégance et déchéance, capable d’apporter une dose de romanesque salvatrice dans les instants les plus glauques. Capable aussi de chanter avec sensualité, mais avec une haleine chargée et un vocabulaire déclinant tous les synonymes possibles du mot « échec ».
Le reste - la musique - sentait la moquette rouge délavée, posée il y a des années sur le sol d’un bordel misérable, depuis maintes fois trouée par les cigarette burns. Trois premiers albums dont la seule constance était d’être abreuvés au même whisky bon marché, servi sans glace et toujours bu cul sec. Quant au sexe, on en parlait surtout sur le mode de la frustration, des pannes sexuelles et des amours usées avant d’avoir été vécues. En tous cas, toujours avortées.
Plus tard, le groupe s’était réinventé sur les cendres d’une rehab désespérée, qui aurait quand même le grand mérite de convoquer les fantômes d’Al Green et Otis Redding. Un virage plus soul, et donc plus chaud, hautement improbable. Ainsi, les deux albums siamois Simple Pleasure et Can Our Love allaient tout d’abord dérouter les premiers auditeurs avant d’en conquérir lentement le cœur et les veines. Néanmoins, cette musique resterait invariablement frelatée. En d’autres termes, peu importe le flacon, du moment qu’on ait l’ivresse, les Tindersticks délivraient toujours cette même cuite aussi misérable que flamboyante.
Certes, les albums suivants allaient s’avérer plus dispensables, sentant davantage l’autoparodie et la bière entamée la veille, finie le lendemain matin faute de mieux. Mais n’en parlons pas ici, tant ces derniers disques restent anecdotiques en comparaison du reste d’une discographie au demeurant impeccable et d’une originalité sans réel équivalent.
D’autant plus que ce long chemin, constant en apparence mais agité en profondeur par des séismes insoupçonnables, allait aussi se retrouver régulièrement court-circuité par les enregistrements de nombreuses bandes originales de films. Et pas les films les plus calmes : ceux de Claire Denis, cinéaste travaillant elle aussi les secousses les plus brutales et sauvages sous des formes tranquilles, ses scénarii tenant en une phrase et l’économie de sa mise en scène donnant systématiquement naissance à des œuvres violentes et vertigineuses.
Il est bon de rappeler cette fructueuse collaboration à l’heure de chroniquer Across Six Leap Years, au fond aussi essentielle que celle qui liait Leone et Morricone. Rarement musiques et images auront trouvé une telle osmose. Trouble Everyday était un exemple marquant, la récente bande originale des Salauds un exemple encore plus manifeste. Une seule écoute, une seule vision, suffit pour marquer le cerveau au fer rouge. Et si on y revient, c’est pour de bon, sous une forme d’intérêt ressemblant avant tout à une forme d’obsession.
La redite, la « nouvelle écoute », c’est pourtant bel et bien à cela que le groupe nous convie aujourd’hui. Ce nouvel effort n’est composé que de morceaux déjà existants, puisés dans un répertoire s’étendant de 1997 à aujourd’hui, mais ici réenregistrés pour l’occasion. Un nouveau disque qui n’en est donc finalement pas un, semblant tout d’abord tenir davantage de la vitrine, voire du musée sentant fort la naphtaline. Erreur. Car si d’entrée de jeu ça sent fort, on avait aussi oublié à quel point on aimait retrouver cette odeur.
Comme une évidence, Across Six Leap Years commence donc dans le sillage de Claire Denis. Étrange destin que cette chanson appelée Friday Night, placée ici en ouverture. Thème principal et éponyme de la bande originale de Vendredi Soir, le morceau a aussi traîné sur un album solo de Stuart Staples. Une entrée en matière douce et sans esclandre, longue et sans heurts, pour mieux préparer la suite, pour mieux cogner ensuite.
Le deuxième morceau asperge brutalement le disque d’une bonne dose de glauque. Marseille Sunshine, lui aussi présent sur l’album solo du chanteur, aurait pu figurer sur une autre bande originale, rappelant également les travaux effectués par Nick Cave lors de ses brillantes compositions pour le cinéma. Témoin d’un déménagement dans le sud de la France (un comble pour ce groupe suintant avant tout la pluie fine et méchante de l’Angleterre), on peut d’ailleurs soupçonner que le titre de la chanson provient en réalité d’une hallucination auditive : en effet, Marseille Sunshine peut aussi apparaître comme une onomatopée de « Marseille Saint Charles », l’annonce que personne ne manquera d’entendre en pénétrant pour la première fois dans la capitale du Sud.
Les deux morceaux suivants franchissent pour de bon la frontière, pour aller visiter des contrées aux sonorités hispaniques, incapables cependant d’en rapporter autre chose que tragédie et mélancolie. Envisagée comme un hommage à Kurt Cobain, ou tout du moins une réflexion sur son suicide, Dying Slowly vante ainsi les mérites de la maladie et de la décrépitude, toujours préférables à la balle d’un calibre 45 administrée trop jeune et en pleine bouche. On n’est pas obligé d’être d’accord, mais la chanson l’assène avec conviction lors d’un refrain sans équivoque que l’on peut aisément traduire ainsi : « Crever lentement, ça me semble mieux que de me flinguer ». Eh ouais. Ce genre d’ambiance.
L’arrivée d’un vibraphone sur If You’re Looking For A Way Out, instrument lunaire par excellence, réchauffe un peu l’atmosphère. Chanson emblématique du virage soul effectué par le groupe au début des années 2000, tous, à commencer par Stuart Staples lui-même, semblaient l’avoir oubliée (« Jamais je n’aurais pensé que cette chanson puisse m’accompagner le reste de ma vie »). Say Goodbye To The City réchauffe encore un peu plus la pièce, flirtant avec le free jazz le temps d’une digression un brin inaudible mais nécessaire.
Il faut attendre le dernier tiers de cette fausse rétrospective pour toucher au sublime. Enchaînant deux classiques du deuxième (et meilleur) disque du groupe, choisissant de ne retenir de cet album prolifique que son introduction et sa conclusion proposées ici en ordre inversé, Sleepy Song et A Night In forcent à se souvenir d’un temps où les Tindersticks enchaînaient les cuites quotidiennes saupoudrées d’une mauvaise toux. Il est incompréhensible qu’aucun grand réalisateur n’ait pensé à mettre à l’honneur ces deux morceaux dans leurs meilleurs longs métrages. Souvenir brutal de dernier instant : A Night In était bel et bien placé en ouverture du film Intimité de Patrice Chéreau, et l’entendre à nouveau aujourd’hui efface en quelques notes toutes les nécrologies plombantes lues au moment de la mort du brillant metteur en scène.
Le reste est plus dispensable. Même réenregistrée, I Know That Loving reste anecdotique, toujours trop longue et manquant d’aspérité. Heureusement, un véritable inédit pour la fin : What Are You Fighting For est un morceau sans âge qui aurait pu figurer sur n’importe quel album du groupe indépendamment des périodes. Il trouve enfin ici une bonne place.
À l’arrivée, Across Six Leap Years n’est pas le best of auquel il pouvait d’abord faire penser. Se situant à mi-chemin entre le travail d’orfèvre exécuté en studio et l’album live brutal (le disque a été enregistré en quelques jours), il s’agit surtout d’une pierre angulaire marquant la discographie d’un groupe auquel on souhaite tout, sauf la sobriété.